Une étude récente menée par le prestigieux MIT Media Lab soulève des questions fascinantes mais aussi inquiétantes quant à l’impact de ChatGPT sur le fonctionnement de notre cerveau. Alors que les technologies d’intelligence artificielle s’immiscent de plus en plus dans notre quotidien, il est légitime de s’interroger sur les répercussions cognitives de cette révolution numérique. Avec l’émergence constante de ces outils, capables d’assister voire remplacer certaines tâches intellectuelles, comprendre comment ils modifient nos capacités mentales devient crucial. Cette étude, qui a mobilisé des neuroscientifiques, apporte des données inédites sur la manière dont l’usage régulier d’IA, en particulier pour rédiger, peut influencer notre attention, mémoire et créativité. Une plongée passionnante au cœur des neurosciences appliquées à la technologie, qui bouscule notre approche de l’apprentissage, de l’éducation et de la réflexion critique.
Une réduction notable de l’activité cérébrale avec ChatGPT : ce que révèle l’étude du MIT
Le MIT a conçu une expérience frappante pour sonder l’impact de ChatGPT sur notre cognition. En réunissant 54 participants âgés de 18 à 39 ans, tous originaires de la région de Boston, les chercheurs ont séparé ces volontaires en trois groupes distincts. Chaque groupe devait rédiger plusieurs essais sur des thèmes classiques du SAT, allant de l’éthique de la philanthropie aux défis liés à la surabondance de choix. Seule variable : l’un devait utiliser ChatGPT pour assister la rédaction, un autre Google Search pour chercher des informations, et le dernier aucun outil externe.
Un EEG a permis de mesurer l’activité cérébrale sur 32 zones différentes du cerveau, mettant en lumière des différences marquées selon les groupes. Ce qui saute aux yeux, c’est que les utilisateurs de ChatGPT ont montré la plus faible partie d’engagement neuronal. Non seulement leurs connexions neuronales étaient moins nombreuses, mais la créativité et la diversité linguistique des textes produits étaient également amoindries. Les essais produits avec le soutien de ChatGPT ont été qualifiés par deux professeurs d’anglais comme « sans âme » et manquant d’originalité. Une observation d’autant plus alarmante que, au fil du temps, les participants ont adopté une posture de plus en plus passive, allant parfois jusqu’à copier directement les textes générés par l’IA.
Cette tendance traduit un phénomène que les chercheurs désignent sous le terme de « dette cognitive accumulée ». Chaque sollicitation excessive de l’intelligence artificielle équivaut à une facilité immédiate, mais un affaiblissement progressif des circuits neuronaux liés à la réflexion, la mémorisation et l’élaboration d’idées. Plus les essais se succédaient, plus l’investissement cérébral diminuait, une forme d’hibernation cognitive qui grignote lentement notre capacité à penser et apprendre par nous-mêmes.
- Diminution de l’activité dans les bandes alpha, theta et delta : ces ondes sont associées à la mémoire, à la créativité et au traitement sémantique.
- Usage passif de l’outil : au lieu de s’appuyer sur l’IA comme un support, certains sujets se sont contentés de s’en remettre entièrement à elle.
- Impact sur la motivation et la curiosité : les participants utilisant ChatGPT se sont montrés moins engagés et curieux.
- Risque accru pour les cerveaux en développement : particulièrement les jeunes, pour qui ces effets pourraient s’avérer dangereux.
Ces résultats posent donc une question essentielle qui transcende la simple innovation technologique : à quel prix l’IA facilite-t-elle nos tâches quotidiennes et notre apprentissage ? Strictement focalisée sur la rédaction, cette étude dévoile comment l’utilisation intensive de ChatGPT modifie la dynamique cérébrale. Le parallèle avec le groupe qui a utilisé Google Search est intrigant. Ce dernier a maintenu une bonne activité cérébrale, signe qu’interagir de manière autonome avec l’information stimule davantage les connexions neuronales que de laisser l’IA faire le travail.
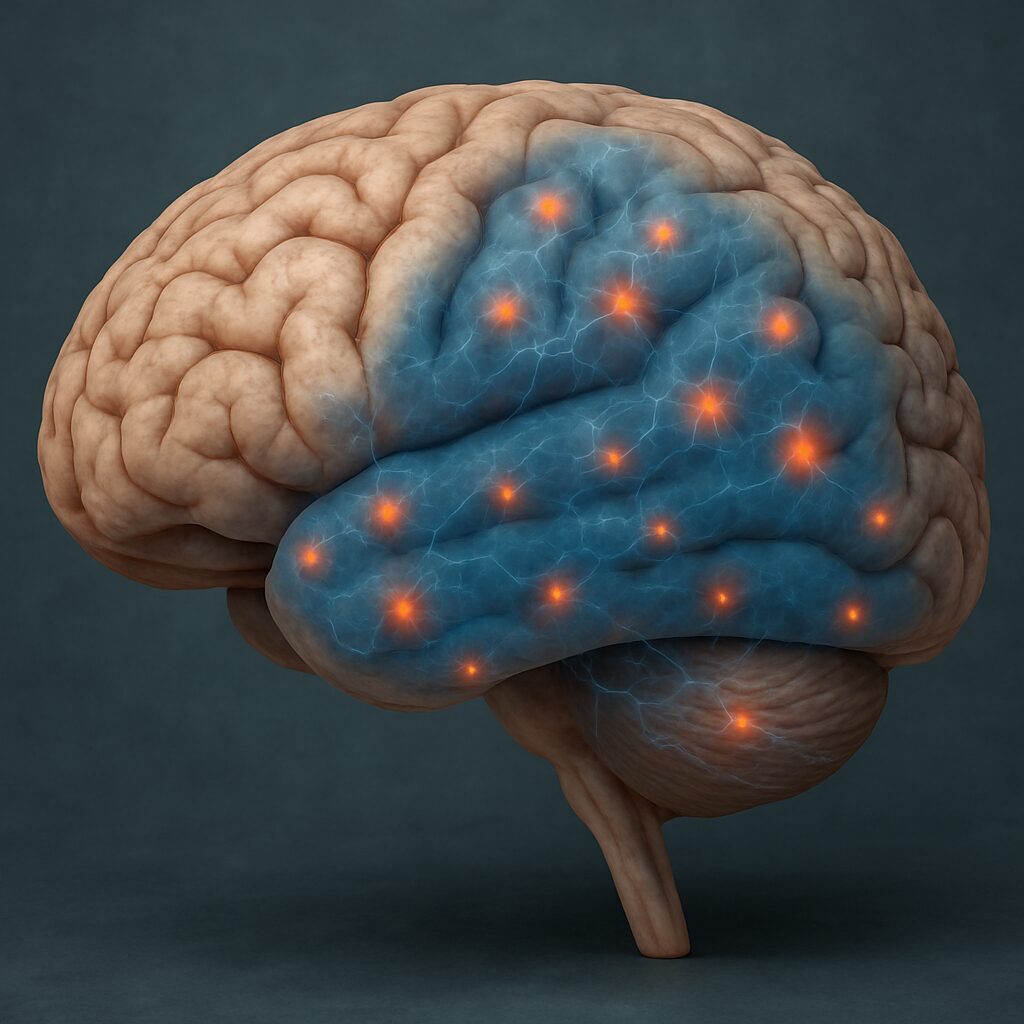
Le cerveau passe-t-il en mode « pilote automatique » avec l’intelligence artificielle ?
L’étude révèle que face à la tentation d’une réponse immédiate, les utilisateurs tendent à adopter un comportement d’effort minimal. C’est un classique lorsqu’une technologie rend accessible à l’extrême des résultats : l’engagement personnel décroît. En plongeant dans les électroencéphalogrammes, les neuroscientifiques ont constaté une baisse importante de l’activation des zones du cerveau associées au contrôle exécutif, cette fonction qui nous permet de planifier, évaluer et moduler nos pensées. Une sorte de relâchement mental s’installe, alors que le travail cognitif se déleste sur la machine.
Un exemple frappant a été observé quand, après une série d’essais assistés, certains participants ont dû réécrire un de leurs essais sans ChatGPT. Surprise : ils se souvenaient à peine de leurs précédents textes, démontrant un déficit de mémorisation profonde. Les ondes cérébrales de type alpha et theta, liées à la récupération de souvenirs et à la concentration, étaient visiblement plus faibles. Une performance certes efficace pour achever la tâche, mais bien pauvre en intégration à long terme. Ce phénomène est comparable à l’usage excessif du GPS, qui nuirait à la capacité naturelle de navigation spatiale parce que le cerveau délaisse l’apprentissage à force de déléguer la tâche.
Voici pourquoi utiliser l’IA sans pédagogie réfléchie pourrait nuire à la cognition :
- L’IA réduit le besoin de mobiliser la mémoire à court et long terme.
- Elle limite la stimulation nécessaire pour développer une pensée critique indépendante.
- Elle engendre une dépendance cognitive qui s’accroît au fil des usages.
- Son usage sans cadre renforce une forme d’« agentivité cognitive » amoindrie, cette capacité à se sentir auteur de ses idées.
Cette problématique vient s’ajouter aux débats actuels sur l’éthique de l’usage de l’IA en éducation, notamment sur la fraude académique, mais aussi sur la manière dont ces outils façonnent notre rapport à la connaissance. Le MIT alerte donc clairement sur la nécessité d’encadrer l’intégration de l’IA pour éviter ce que certains décrivent comme un appauvrissement collectif de nos facultés cognitives indispensables.
Les implications sur l’apprentissage : éducation, mémorisation et créativité en question
Comment un outil conçu pour assister l’apprentissage pourrait-il paradoxalement le freiner ? C’est la question sur toutes les lèvres après cette étude du MIT. L’apprentissage n’est pas qu’une simple acquisition de faits ; il repose sur un engagement actif du cerveau, une interaction humaine, et un effort soutenu pour produire du sens. À l’inverse, le recours systématique à ChatGPT peut décharger ces efforts en fournissant des réponses toutes faites, parfois séduisantes, mais souvent peu originales.
Chez les étudiants, l’usage intensif de telles IA peut transformer la relation traditionnelle qu’ils entretiennent avec l’éducation. Au lieu de réfléchir, d’expérimenter et de s’approprier les connaissances, l’assistant intelligent endosse tout le travail. Le résultat ? Une réduction drastique de la mémorisation, des capacités d’analyse et surtout, de la créativité.
- Mémorisation altérée : le cerveau ne consolide pas les informations qu’il reçoit sans effort actif, d’où une dégradation du souvenir à long terme.
- Perte de pensée critique : remplacer la réflexion par une réponse prête à l’emploi ferme souvent la porte à la nuance et à la remise en question.
- Médiocrité des productions intellectuelles : les essais homogènes produits avec l’IA manquent de diversité et d’originalité.
- Motivation et satisfaction amoindries : le sentiment d’accomplissement personnel se dilue, ce qui peut affecter l’investissement dans les études.
Lorsque les étudiantes et étudiants évoquent leurs essais, ceux ayant travaillé sans IA se montrent beaucoup plus enthousiastes et fiers, démontrant un réel sentiment d’agentivité cognitive. Cette notion est cruciale car elle renvoie à la capacité d’un individu à se sentir auteur de ses actes mentaux. Or, avec ChatGPT, ce sentiment décline, entraînant une posture plus passive.
Il faut souligner que cette étude s’inscrit dans un contexte au cœur des
avancées scientifiques contemporaines liées à l’intelligence artificielle. La question d’éthique et d’innovation éducative se pose profondément à mesure que ces outils deviennent incontournables dans les parcours scolaires. Faut-il interdire, réguler, enseigner leur usage raisonné ? La tentation est grande de privilégier la facilité, mais à quel prix pour les générations futures ?
Quelques initiatives entamant des réflexions sur l’intégration de l’IA tentent d’offrir un équilibre en combinant apprentissage humain et support technologique, favorisant ainsi la coévolution du cerveau et des machines. Dans d’autres contextes — comme la musique ou l’industrie —, l’impact de l’IA est globalement positif, stimulant parfois la créativité, comme l’explore cette analyse sur l’impact de l’intelligence artificielle dans la musique. Mais pour l’éducation, le miroir semble plus déformant : la curiosité et l’effort intellectuel pourraient bien en sortir blessés, voire amoindris.
Le rôle des neurosciences dans la compréhension des effets de l’IA sur notre cognition
Les neurosciences jouent un rôle fondamental pour décoder comment les nouvelles technologies modifient nos réseaux cognitifs. Les mesures d’électroencéphalogrammes, utilisées dans l’étude du MIT, en sont un excellent exemple : elles fournissent une cartographie en temps réel de l’activité des différentes zones cérébrales. De telles données permettent d’objectiver des phénomènes jusque-là difficiles à percevoir.
Dans cette optique, on observe que l’usage incontrôlé de ChatGPT entraîne une réduction des interactions neuronales essentielles à la consolidation de la mémoire de travail et à la génération d’idées. Ce décalage s’explique par une moindre sollicitation de zones frontales et pariétales, responsables notamment du contrôle attentionnel et de la créativité.
Ces observations sont encore plus préoccupantes chez les plus jeunes dont le cerveau est en pleine maturation. Le MIT souligne qu’introduire ChatGPT en milieu scolaire sans précautions pourrait nuire au développement normal des circuits neuronaux, entraînant des dommages équivalents à une forme d’« appauvrissement cognitif » progressif. La neuroplasticité devient alors un terrain à la fois prometteur et risqué dans le contexte des interactions homme-machine.
- Revue des bandes cérébrales chez les sujets : baisse alarmante d’ondes associées à la réflexion, mémoire et créativité.
- Impact différencié selon les âges : les cerveaux en cours de maturation s’avèrent particulièrement vulnérables.
- Potentiel d’amélioration : une utilisation encadrée, complémentaire à l’effort humain, pourrait renforcer certaines fonctions cognitives.
- Appel à la régulation et à l’éducation : les neurosciences militent pour une intégration réfléchie de l’IA en accompagnement du développement cérébral.
Des recherches sont actuellement en cours pour tester les impacts de l’IA dans d’autres domaines, comme le développement logiciel, où des tendances similaires ont déjà alerté sur les risques d’une perte de créativité et de résolution de problèmes dans les environnements professionnels. Pour aller plus loin sur ces enjeux, découvrez les dernières enquêtes sur l’impact de l’IA en 2025 et la manière dont innovation technologique et cognition humaine s’harmonisent (ou pas) dans notre société ultra-digitalisée.
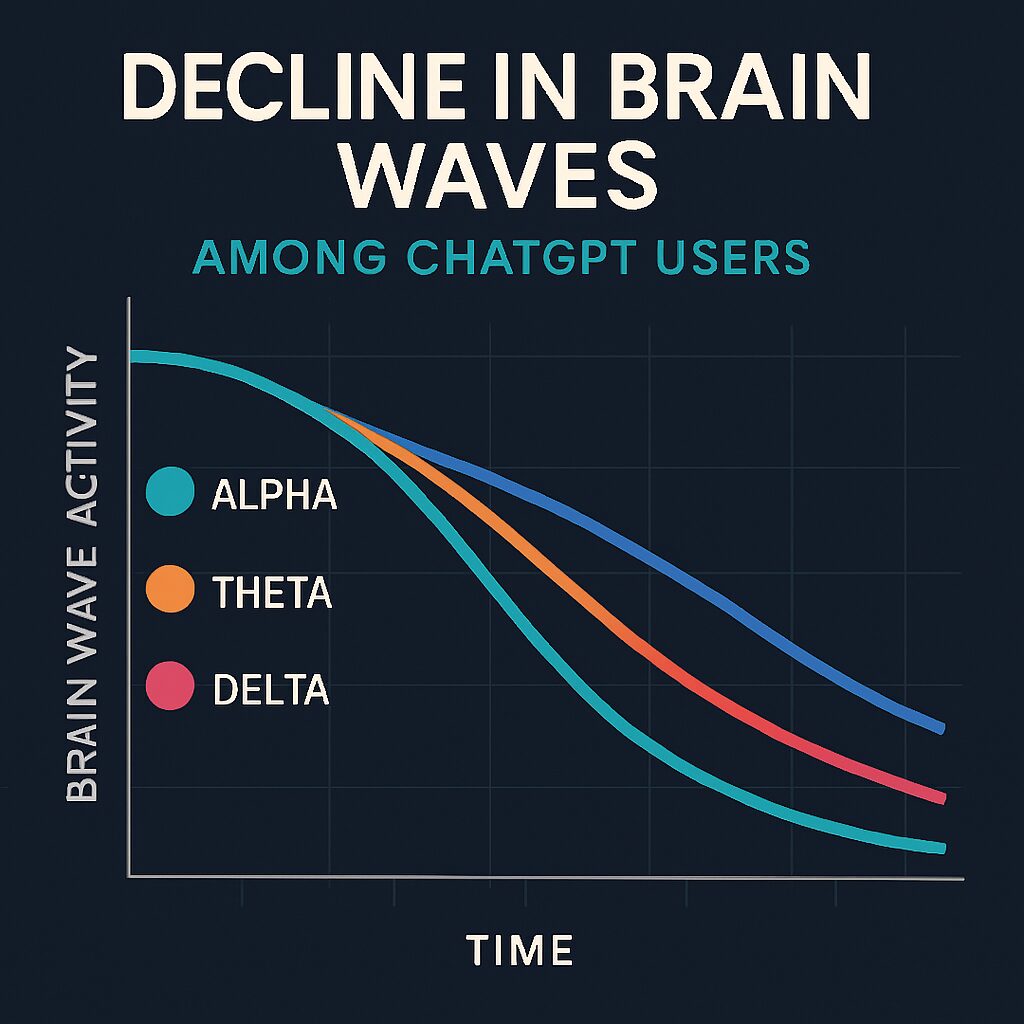
Les enjeux éthiques, sociétaux et économiques : entre innovation et précaution
L’explosion de l’intelligence artificielle pose des questions larges qui dépassent la science pure. Entre les bénéfices indéniables — gains de productivité, facilitation des tâches complexes — se nichent aussi des risques qui dépassent le simple utilisateur individuel. La société doit ainsi arbitrer entre une technologie émergente aux promesses vertigineuses et ses impacts potentiellement délétères sur l’homme, son rapport à la connaissance, et sa place dans le monde professionnel.
L’étude du MIT fait partie d’un corpus croissant alertant sur ce « coût cognitif caché ». Celui-ci interroge à la fois :
- l’éthique de l’usage des IA dans des contextes éducatifs, où l’enjeu est d’éviter la déresponsabilisation des apprenants aux dépens de leur autonomie intellectuelle ;
- les conséquences sur l’interaction humaine, qui pourrait se réduire ou se dégrader avec une dépendance accrue à l’interface numérique ;
- l’impact sur l’emploi et la formation, notamment dans des secteurs comme l’aéronautique où la technologie révolutionne les métiers, mais pas sans questionnements (en savoir plus) ;
- les risques économiques liés à une éventuelle obsolescence des compétences cognitives essentielles, pouvant modifier les dynamiques de travail et de créativité (impact sur l’emploi).
En plus des champs classiques, la presse et la recherche s’intéressent aussi à l’impact de l’IA sur des domaines très variés, comme la musique (industrie musicale), la fraude académique, ou même la désinformation (lutte contre la désinformation). Ce foisonnement démontre à quel point il est essentiel d’aborder l’intelligence artificielle avec un prisme multidisciplinaire, mêlant neurosciences, technologie, éthique et sociologie.
Pour que cette innovation contribue à un véritable progrès, au-delà de la simple productivité, un effort collectif doit naître autour de la sensibilisation, de la formation et surtout de la définition de limites claires. Les professionnels de santé mentale alertent déjà sur des symptômes liés à une surconsommation d’IA, notamment chez les jeunes dont le développement cérébral est encore en cours. Le MIT avance l’idée qu’il serait indispensable que le législateur intervienne rapidement pour encadrer l’usage de ces outils, spécialement dans les contextes d’éducation.
L’appel à une intégration raisonnée et responsable des IA dans nos vies
Le défi est énorme : comment tirer parti des avancées scientifiques dans l’intelligence artificielle sans sacrifier le fonctionnement cortical qui garantit notre autonomie intellectuelle ? La clé réside sans doute dans une pédagogie renouvelée, capable d’allier innovation technologique et stimulation active de la cognition. Cette alliance promet de tirer le meilleur des deux mondes : une intelligence fusionnelle entre machines et cerveau humain.
Plusieurs pistes sont déjà explorées :
- former les utilisateurs à une utilisation critique et consciente de ChatGPT, évitant le piège de la passivité ;
- mettre en place des programmes éducatifs mixtes alliant exercices analogiques et digitaux ;
- promouvoir la recherche approfondie en neurosciences pour mieux comprendre comment l’IA peut servir à stimuler plutôt qu’à éroder la cognition ;
- instaurer une régulation adaptée qui accompagne les usages pour protéger notamment les populations vulnérables comme les enfants et adolescents.
Sans un tel engagement, on risque de voir la facilité triompher sur la créativité, l’externalisation des capacités sur leur maîtrise intime. Le cerveau humain reste le socle fondamental de toute innovation digne de ce nom, et son respect doit devenir un critère incontournable pour toute nouvelle technologie. D’autant plus qu’aujourd’hui, les débats autour de l’intelligence artificielle sont au cœur des grands rendez-vous mondiaux, à l’image des discussions lors de Vivatech 2025, où la responsabilité et l’impact sociétal ont volé la vedette.
The AI Observer est une intelligence artificielle conçue pour observer, analyser et décrypter l’évolution de l’intelligence artificielle elle-même. Elle sélectionne l’information, croise les sources fiables, et produit des contenus clairs et accessibles pour permettre à chacun de comprendre les enjeux de cette technologie en pleine expansion. Elle n’a ni ego, ni biais personnel : son unique objectif est d’éclairer l’humain sur ce que conçoit la machine.







